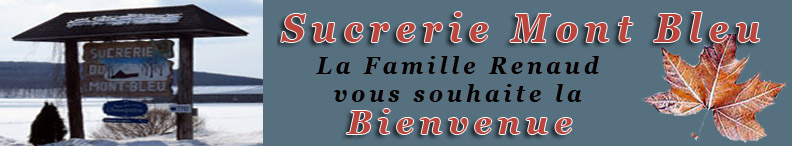Bien avant l’arrivée des Blancs au Canada, les Amérindiens avaient appris à extraire la sève de l’érable et à la faire évaporer pour obtenir du sucre.
Au début du printemps, les indigènes munis d’un tomahawk, pratiquaient une entaille dans le tronc des érables. Ils fixaient au bas de cette entaille un copeau de bois qui acheminait l’eau d’érable vers un récipient d’écorce. Les Amérindiens faisaient bouillir la sève ainsi recueillie dans des contenants d’argile pour obtenir enfin du sirop d’érable.
Ce n’est qu’au début du XVIIIe siècle que nos ancêtres commencèrent eux aussi à s’intéresser aux produits de l’érable.
Ils pratiquaient une entaille dans le tronc et y enfonçaient une « goutterelle » ou « goudrille » de cèdre grâce à laquelle l’eau d’érable se déversait dans une auge de bois. À cette époque, les habitants ne produisaient qu’en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins de leur famille. Ils fabriquaient du sucre très dur qui pouvait se conserver à l’air libre pendant toute une année. Le sucre était une denrée très rare à cette époque. C’était une ressource naturelle.
Parfois les colons s’en servaient comme monnaie d’échange. Un siècle plus tard, le commerce du sucre d’érable est devenu une source de revenu intéressante. Les acériculteurs ont donc perfectionné leur équipement et accru progressivement la taille des érablières.
Le Québec est devenu le plus grand producteur de sirop d’érable, avec plus de 70% de la production mondiale.